Pourquoi embarquer
dans cette démarche ?
Climat de
changement
Climat de
changement
Vous avez des pouvoirs insoupçonnés à votre portée pour jouer un rôle dans
l’action climatique. C’est pourquoi nous vous accompagnons.
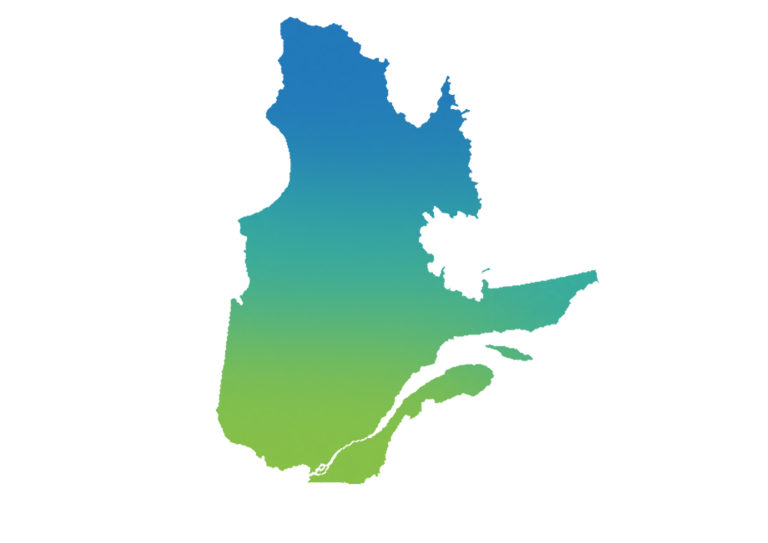
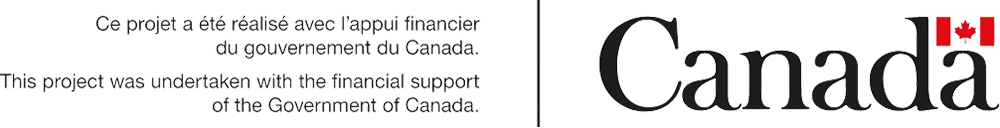

Les bâtiments sont responsables de 10% des émissions de GES et de 32 % de la consommation d’énergie du Québec. En effet, 28 % de l’énergie des bâtiments (46 % pour les bâtiments commerciaux et institutionnels et 13 % pour les résidentiels) est d’origine fossile (gaz et mazout notamment) et 25 % de l’énergie produite pour les bâtiments au Québec est perdue.
Les solutions à mettre en place sont : utiliser une thermopompe, un chauffage électrique ou la géothermie, rénover l’isolation thermique, mettre le chauffage à 19°C et la climatisation à 26°C, utiliser des matériaux biosourcés ou bas carbone
Finalement, les bâtiments devront s’adapter à un climat changeant notamment grâce à des stratégies passives et bioclimatiques.
Source : https://www.cer-rec.gc.ca
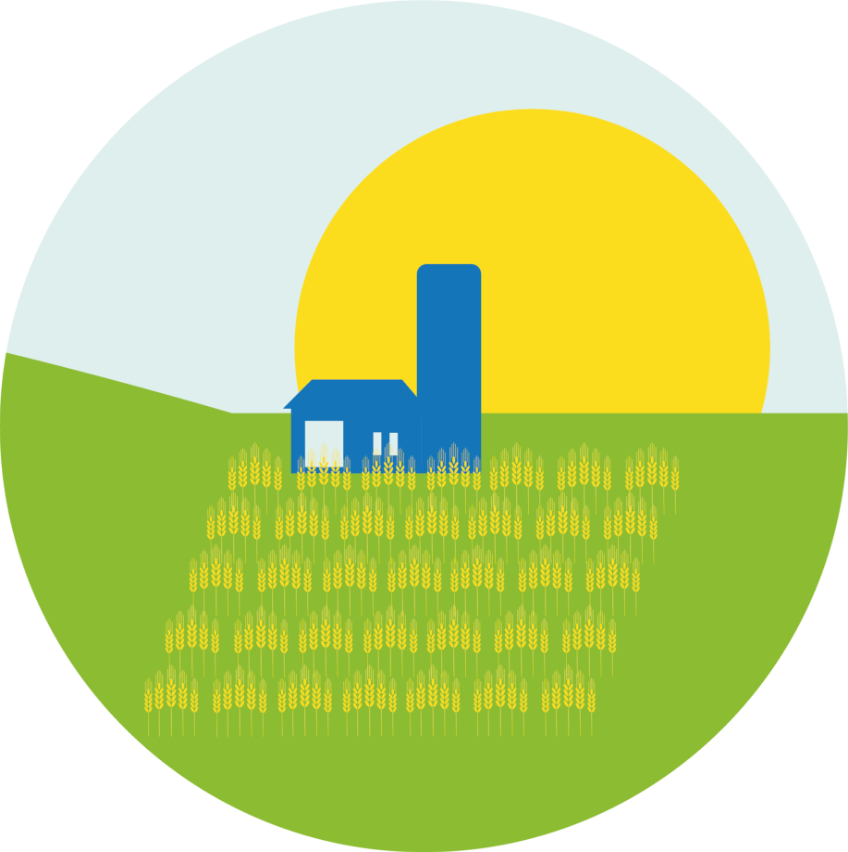
Sécheresses, chaleurs extrêmes, pluies intenses, épidémies d’insectes, espèces exotiques envahissantes, feux de forêts : autant d’aléas climatiques extrêmes qui vont devenir plus fréquents et impacter notre agriculture et nos forêts.
En plus de l’adaptation au changement climatique, ces deux secteurs sont des éléments clés de la lutte contre celui-ci, notamment grâce à la séquestration de carbone.
Il est possible d’appliquer les solutions suivantes :
Source :

Le changement climatique est la 3ème cause de perte de biodiversité dans le monde, et pourrait devenir la 2ème ou 1ère dans les prochaines décennies. En retour, une biodiversité et des milieux naturels en bonne santé sont nécessaires (impératifs ? primordiaux ?) pour stabiliser le climat, dont notamment les milieux humides comme les tourbières qui stockent 9 fois plus de carbone que les forêts.
Parmi les solutions déployables, il est possible de : participer à l’extension des aires protégées, notamment en identifiant les lieux admissibles au statut de zone protégée de type paysage humanisé, et en présenter la demande ; adhérer au Fonds des municipalités pour la biodiversité ; inclure des corridors écologiques dans l’aménagement du territoire ; ou encore restaurer les milieux humides.
Source :
https://ipbes.net/global-assessment

Plus de 96 % des ressources circulant dans l’économie québécoise ne sont pas réutilisées. En effet, l’indice de circularité de l’économie québécoise est de 3,5 % ; tandis que la moyenne mondiale est de 8,6 %.
De multiples solutions sont déployables pour réutiliser un produit ou revaloriser ses composants et matières après utilisation :
Source :

54 % de l’énergie consommée au Québec est toujours d’origine fossile (pétrole et gaz notamment), alors que cette part était déjà de 58 % en 1987. Entre-temps, la consommation d’énergie par habitant a augmenté de 21 %. De plus, 52 % de l’énergie totale au Québec est aujourd’hui perdue à cause de l’inefficacité du système énergétique. Par conséquent, le Québec consomme plus de 4 fois plus d’énergie par habitant que la moyenne mondiale et le Canada est le 11ème pays au monde qui consomme le plus d’énergie par habitant.
Face à cela, il est possible de : diminuer voire supprimer les usages énergétiques inutiles, développer des quartiers “15 minutes” et densifier les villes, développer l’efficacité énergétique, électrifier des usages énergétiques (transport et chauffage notamment),
Source :
https://ourworldindata.org/per-capita-energy

Verdir nos milieux de vie permet d’atténuer les causes, mais aussi les effets, des changements climatiques. D’une part, la végétation capte et séquestre du CO2 ; d’une autre, elle lutte contre les îlots de chaleur en rafraîchissant nos villes et limite les risques d’inondation en absorbant les eaux pluviales.
Dans le cas des villes artificialisées, le verdissement et les infrastructures vertes sont un moyen de s’adapter à ces changements, comme par exemple : les systèmes végétalisés de gestion d’eaux pluviales, les toits verts et murs végétaux, les stationnements semi-imperméables, les parcs et corridors écologiques, l’agriculture urbaine, etc.
8 % des émissions de GES du Québec proviennent de la gestion des déchets et des eaux usées municipales. Notamment, 91 % de ces GES proviennent de la décomposition de la matière organique dans les lieux d’enfouissement municipaux.
Les solutions à mettre en place sont assez simples : développer un service de collecte de la matière organique (compost) et récupérer le gaz s’échappant des sites d’enfouissement.

Le transport est le 1er secteur émetteur de GES (43 %), et celui le plus en hausse (+35 %) depuis 1990, au Québec. En particulier, de 1990 à 2019, la part des camions (dont notamment les VUS) parmi les véhicules neufs vendus est passée de 24 à 69 %, et les émissions de GES des camions légers et des véhicules lourds ont augmenté de 158 et 194 % respectivement. De plus, le secteur des transports est particulièrement dépendant des énergies fossiles qui représentent 98 % de ses carburants.
Face à cela, il est nécessaire de réduire notre dépendance à l’auto solo en aménageant des villes et quartiers “15 minutes” via la densification et des services de proximité. Les modes de transport collectifs et actifs doivent devenir la priorité, tout comme les stationnements peuvent être réduits et mutualisés. L’accès et la recharge des véhicules électriques doivent également être facilités.
Source :